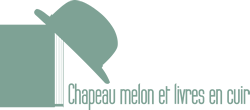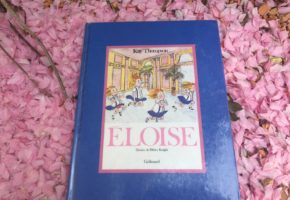Il gravit les marches du métro d’un pas décidé et se rue presque à l’air libre. La proximité du musée du Jeu de Paume fait remonter en lui les souvenirs des clichés de Diane Arbus, André Kertész ou Vivian Maier, des photographes qui l’ont bouleversé, chacun pour une raison particulière. Il se rappelle dans quelles circonstances et avec qui il a visité ces expositions et reste quelques instants perdu dans ses pensées. Puis revient à lui brusquement : il n’a pas le temps pour la nostalgie, il est attendu.
Il s’engage dans la rue de Rivoli tout en longeant le jardin des Tuileries. Bientôt l’été et, avec lui, la grande roue, les stands de jeux, les manèges, qui reviendront s’établir ici, faisant la joie des petits comme des grands. Même seul, il tâchera d’y aller cette année.
Quelques mètres encore et il traverse la rue, s’engouffre sous les arcades et s’arrête devant le numéro 228. De l’extérieur, le bâtiment passe presque inaperçu, sa façade de style haussmannien se confondant volontiers avec celle des immeubles voisins. Il est salué par le groom, en costume noir, chapeau rond caractéristique et gants blancs, gravit les trois marches, pousse la porte tournante et parvient dans le hall d’entrée. Il est venu l’année dernière à la même époque et pourtant : le faste du lieu le saisit une nouvelle fois. Une profusion de colonnes, de miroirs et de fauteuils de style Louis XVI l’accueille et il se sent propulsé dans un autre temps. S’il pouvait choisir, il s’imaginerait au début du XXe siècle, à côtoyer tous les grands de ce monde qui ont établi ici leurs quartiers parisiens. Il se dirige vers le comptoir en foulant, au sol, une splendide mosaïque de marbre.
_ Bonjour Monsieur, bienvenue à l’hôtel Meurice. Que puis-je faire pour vous ?
_ Bonjour, j’ai réservé une table au restaurant Meurice.
_ Bien sûr Monsieur, je vais prévenir le restaurant. C’est à quel nom ?
_ Julien Davenne.
Julien Davenne, du nom du héros veuf du film de Truffaut, La chambre verte. Un patronyme qui pour lui prend tout son sens, qu’il utilise régulièrement depuis des années, mais qui demeure suffisamment confidentiel pour ne pas éveiller les soupçons chez ses interlocuteurs. Un appel est passé puis, dans la minute, le maître d’hôtel, costume trois pièces bleu marine, la raideur en étendard, vient à sa rencontre, se présente avec tout le cérémonial que requiert sa fonction puis le conduit à une table ronde, placée le long d’une fenêtre.
Quel cadre magnifique ! pense-t-il en regardant autour de lui. Les lustres de cristal rivalisent de splendeur avec les marbres, les bronzes les fresques sur les murs et au plafond, dans une harmonie subtile d’or et de blanc. Tout cela produit sur lui un sentiment de déférence, telle que celui qu’il peut avoir en pénétrant dans un lieu sacré. D’ailleurs, les autres clients semblent au diapason : ne parviennent jusqu’à lui que de lointains chuchotements et bruits de couverts.
Il prend connaissance du menu puis, à peine quelques minutes plus tard, le maître d’hôtel vient s’enquérir de son choix.
_ Ce sera le tourteau, suivi du tronçon de turbot, blettes et coquillages.
_ Très bien Monsieur. Et pour finir ?
_ Je prendrai le baba au rhum.
Le maître d’hôtel a à peine tourné le dos qu’une jeune femme fait son apparition et dépose sur la table encore immaculée un panier de pains – blanc, complet, au sésame, au pavot, aux céréales, aux noix, il y en a vraiment pour tous les goûts – et du beurre. L’alliance est divine, à mille lieux des tartines qu’il se prépare chaque matin.
Les amuse-bouches arrivent à leur tour, la farandole de légumes cuits sur des rochers de sel et accompagnés d’une tapenade maison – à se damner – puis le médaillon de chèvre au miel – un régal. Dès qu’il termine son verre d’eau, un chef de rang surgit à pas feutrés d’on ne sait où pour le resservir, puis repart aussi discrètement qu’il est arrivé.
L’entrée est une merveille pour les yeux et les papilles. Le tourteau est enveloppé dans de fines lamelles de courgettes surplombées d’un zeste de pamplemousse, et accompagné de caviar gold et d’une de ses pinces. Sans oublier deux fines tranches de pain incrustées de courgettes et de corail. Le tout compose un véritable tableau dans les tons vert, rouge et or. Et la saveur en bouche est grandiose. Le plat le laisse sur son petit nuage. Le turbot, cuit à la vapeur, est servi avec ses tiges rouges de blette et une ronde de coquillages, tous plus succulents les uns que les autres. Il prend le temps de savourer chaque plat, il sait qu’il s’est engagé dans un marathon gustatif, il lui faut rester raisonnable. A chaque mets, il sort son téléphone et prend une photo, en douce, tel un touriste ou un simple gastronome. Il ne faut pas oublier ce qu’il a goûté, surtout.
Le sublime baba au rhum est précédé d’une ronde de sorbets acidulés qu’il déguste lentement. A la fin du repas, il s’attarde quelques minutes et tente de regrouper ses impressions. Il passe en revue, mentalement, la qualité des produits, la maîtrise des cuissons, la créativité, le rapport qualité-prix et la régularité. A son arrivée, le maître d’hôtel lui a présenté les produits utilisés, leur provenance. Bon point. Le turbot était-il parfaitement cuit ? Et la présentation était-elle digne de celle qui l’a subjugué dans un autre palace le mois dernier ? L’ensemble valait-il le prix affiché ? Rassembler ses idées. Ne pas se laisser influencer par le cadre et le service, en tous points parfaits ici, mais qui ne sont pas pris en compte.
Il règle la note, traverse le somptueux hall d’entrée dans l’autre sens et se retrouve dehors, dans un concert de klaxons. Il fait quelques mètres avant de trouver refuge dans un café qu’il a repéré au préalable. Là, à l’abri de tous, il peut sortir son carnet et prendre des notes, enfin. Seul son stylo pourrait le trahir : la mention « Guide Michelin » y est inscrite sur la tranche, en fines lettres dorées.
Bérengère de Chocqueuse